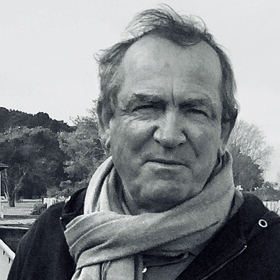

.jpg)
Daniel Morvan
À quoi rêvent
les martyrs
Roman
2025. 224 p. 15/22.
ISBN 978.2.86853.729.4
20,00 €
Le livre
Dans la nuit du 29 septembre 1941, un bombardier britannique, touché par la flak, amerrit en catastrophe dans la baie de Saint-Michel-en-Grève. Ses trois aviateurs sont recueillis par Marie de Saint-Laurent, une mère de famille nombreuse, avec l’aide de deux autres femmes. Le réseau d’évasion qui se met alors en place se heurtera bientôt aux représailles déclenchées par l’assassinat à Nantes d’un officier allemand ami d’Hitler. Et Gilberte, jeune résistante courageuse, qui tente de protéger à son tour les aviateurs anglais se trouve prise, avec les autres protagonistes de cette histoire, dans la tourmente. Les soubresauts de la Guerre les mèneront à travers l’Europe, de la carrière des fusillés de Châteaubriant au Stalag Luft III, théâtre d’une célèbre évasion de masse, jusqu’à l’enfer de Ravensbrück. Dans leur périple à travers ces lieux tragiques, les captifs se battent pour survivre et préserver leur humanité : oui, les martyrs ont des rêves, qui sont les rêves de leurs frères humains.Alors que les derniers témoins s’effaçaient, Daniel Morvan a recueilli les souvenirs de Maguy, fille centenaire de Marie de Saint-Laurent. Rapprochant son témoignage des faits réels retenus par l’Histoire, il a composé dans une langue somptueuse cette fiction vraie, roman poignant qui explore les thèmes de la résistance, de la mémoire et du sacrifice — et qui est aussi un inestimable acte de transmission.
L’auteur
Né à Morlaix en 1955, Daniel Morvan est un écrivain dont l’œuvre est profondément marquée par l’imaginaire breton. Son enfance et son adolescence passées dans le Finistère et les Côtes d’Armor ont nourri ses livres, et influencé son écriture, faisant de la Bretagne le décor privilégié de ses romans. Il est aujourd’hui publié aux éditions du Temps qu’il fait. Son œuvre, à la fois poétique et engagée, s’intéresse à l’histoire, à la mémoire et à l’identité, faisant de lui une des belles voix de la littérature française contemporaine.
Extrait
10.
Gilbert Brustlein
Lundi 20 octobre 1941, Nantes. Bousiller un type à froid, comptez pas sur moi. Méthodes d’anarchistes ça, que je leur avais dit. J’avais mes vapeurs. Mais on se fait une raison : à vingt-deux ans, on y tient à l’estime des aînés et vaille que vaille on suit les ordres du Parti. Ils te liquident comme social-traître si tu te défiles. Et on ne parle pas de meurtre, là, mais d’exécution d’un gradé, le premier qui passe tu cherches pas plus loin, tu défourailles et tu files. Dire qu’il ne faut pas tuer les ennemis c’est à peu près comme dire : Laissons faire les grands, les Anglais. Ça serait digne d’un communiste ?
Cela s’est passé à Nantes de cette façon, sans trembler, sans rien laisser voir de ce qu’on était : des débutants, mais avec un idéal, et toute l’audace du communiste en mission. Mission qui découle directement de l’invasion de l’Union soviétique par les troupes allemandes en juin 1941 (nom de code Barbarossa), rompant, le jour anniversaire de l’armistice entre la France et le IIIe Reich, le pacte d’amitié germano-soviétique d’août 1939. Ce traité avait offert la Pologne sur un plateau à Hitler, lui permettant de s’engager pleinement dans son projet : la dévastation de l’Europe par le Blitzkrieg. L’archipel britannique avait combattu seul une année entière. Juin 1941 : en l’absence de front à l’ouest, l’Allemagne peut jeter dans l’offensive les trois corps d’armée massés à la frontière de l’URSS. Cette guerre totale contre l’Union soviétique et pour la conquête de l’espace vital est aussi, à l’arrière du front, la première guerre génocidaire de l’histoire humaine, par l’extermination de masse des populations juives, tziganes, ainsi que des partisans communistes. L’Armée rouge doit, selon les plans allemands, être vaincue avant le début de l’hiver, et repoussée à l’ouest de la ligne Arkhangelsk-Astrakhan, depuis la mer Blanche, au nord de la Russie, jusqu’à l’embouchure de la Volga sur la mer Caspienne.
Jouant de l’effet de surprise, la Wehrmacht ouvre à l’est le principal front militaire de la Seconde guerre mondiale, et fait reculer l’Armée rouge, qui s’adosse aux murs de ses bastions au-delà desquels la Wehrmacht n’ira jamais (mais on en doute alors fortement) : Léningrad, Moscou, Stalingrad; elle recule de mille kilomètres; Staline déplace son industrie dans l’Oural et en Sibérie.
Ce qui se joue alors, c’est le sort de la Russie soviétique, c’est le sort de Moscou qui, en octobre, s’encercle de fortifications et de huit mille kilomètres de tranchées, barricades, fossés antichars, se couvre de chevaux de frises et de hérissons tchèques pour contrer l’avancée des blindés. Après avoir atermoyé, la Wehrmacht livre en octobre l’assaut frontal sur les premières défenses moscovites; les Panzers seront bientôt à vingt kilomètres du Kremlin.
Ce qui ne se joue pas, c’est le sort de la France, occupée, ligotée, muselée. Le sort est déjà tranché. Seul un général de brigade à profil de marionnette s’agite à Londres, formant d’une cohorte de partisans français une légion de reconquête.
Pétain a déjà renversé la citadelle communiste dans son propre pays, et le maire Rondeau en a fait de même dans sa ville de Nantes. Le premier mai ouvrier est devenu fête nationale de la saint Philippe. Ni Pétain ni Rondeau n’attendent aucune riposte, aucun cheval de frise, aucun hérisson tchèque, aucun tankiste russe. Ils seront pourtant là où personne ne les attend, devant la cathédrale de Nantes le 20 octobre 1941.
Tuer un officier : un tel acte ferait basculer le pays, la France allait sortir de sa léthargie. À vingt-deux ans, se disait Gilbert, on y réfléchit. On va jouer à front renversé et prouver que si Moscou est menacée, les communistes de France ne restent pas inertes. Nous ouvrirons un nouveau front à l’ouest. Je serai ce front. Nous ajouterons l’immense audace de trois hommes à l’immensité russe, au courage des bolcheviks biélorusses, aux soldats, artisans, ouvriers, professeurs qui rejoignaient les partisans de la forêt.
Existait-il quelque part dans cette ville de Nantes un brave homme d’officier allemand assez dévoué pour mourir au coin d’une rue ? La question travaillait Gilbert. Mais on en avait assez passé de dimanches d’entraînement militaire en forêt du Lardy, à jouer aux scouts, à poignarder des ombres d’ennemis avec des ombres de couteaux. Si cela ne t’ouvre pas un boulevard pour entrer dans l’histoire et avoir une rue à ton nom, ou disons, une impasse de lotissement à Novossibirsk, c’est à désespérer du sens de l’Histoire. Alors mon vieux, quand cela se présente, tu attrapes le billet que la chance te tend et tu exécutes les ordres : les Allemands ne campent-ils déjà pas aux portes de Léningrad ? Ne s’apprêtent-ils pas à saigner Moscou ? Trois millions de soldats allemands n’envahissent-ils pas la terre russe ?
Le plan de l’organisation secrète communiste (sous l’autorité du Komintern) était d’envoyer trois groupes de brûlots à Rouen, Nantes et Bordeaux. Objectif double de chaque commando : faire dérailler un train et exécuter des officiers dans la rue. Mais (revenait la même question) on va le trouver où, ce frisé suicidaire ? Au quai de la Fosse ? Au mess de la Wehrmacht ? Sans oublier que l’homme que tu vas exécuter peut très bien être, politiquement, un frère. Un communiste sous l’uniforme, un camarade de Hambourg ou de Wiesbaden, un fils de prolétaire de la banlieue de Berlin ou un étudiant marxiste de Stuttgart. Pourtant Brustlein très vite se convertit, sous l’effet d’une démonstration du camarade Georges.
Philippe Gestin
27 novembre 2025
Patrick Corneau
5 novembre 2025
Jean-Claude Lebrun
17 novembre 2025